De l'antisepsie médicale
- Classe de ressource
- Thesis
- DESCRIPTION
- TABLE DES MATIÈRES
- VOIR PLUS
- Identifiant
- ark:/13685/90975x1886x07x05
- Titre
- De l'antisepsie médicale
- Créateur
- Lemoine, Georges-Henri
- Date
- 1886
- Éditeur
- Paris : A. Parent, impr. de la Faculté de Médecine - A. Davy, successeur
- Siècle
- XIXe siècle
- Format
- Nombre de vues : 184
- Notes
- Présentée au concours pour l'agrégation (Médecine et médecine légale)
- Source
- Université Paris Cité. BIU Santé Médecine, inv. 90975
- Date de mise en ligne
- 13 septembre 2021
- Propriétaire
- Université Paris Cité. BIU Santé Médecine
- Licence
- Licence Ouverte
- Table des matières
-
![0001 - Page sans numérotation - [Page de titre]](https://numerabilis.u-paris.fr/iiif/2/bibnum:90975x1886x07x05:0001/square/200,/0/default.jpg) 0001 - Page sans numérotation - [Page de titre]
0001 - Page sans numérotation - [Page de titre]
-
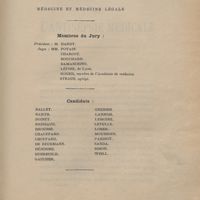 0003 - Page sans numérotation - Membres du jury / Candidats
0003 - Page sans numérotation - Membres du jury / Candidats
-
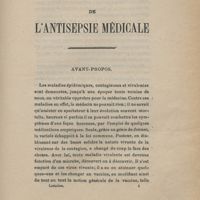 0005 - Page 1 - De l'antisepsie médicale. Avant-propos
0005 - Page 1 - De l'antisepsie médicale. Avant-propos
-
 0009 - Page 5 - Introduction
0009 - Page 5 - Introduction
-
 0018 - Page 14 - 1° Par la porte ectodermique / 2° Par la porte que l'on pourrait appeler entodermique
0018 - Page 14 - 1° Par la porte ectodermique / 2° Par la porte que l'on pourrait appeler entodermique
-
 0019 - Page 15 - 3° Par une porte d'entrée que l'on pourrait appeler cloacale
0019 - Page 15 - 3° Par une porte d'entrée que l'on pourrait appeler cloacale
-
 0024 - Page 20 - Chapitre premier. Prolégomènes. Principes généraux de l'antisepsie médicale. I. L'antisepsie s'adresse aux maladies infectieuses. - Malignité. - Contagion. - Épidémicité. - Maladies qui vaccinent. - Maladies qui ne vaccinent pas. - Maladies qui prédisposent à une nouvelle atteinte. - Notions générales sur les conditions d'existence des germes pathogènes. - Leurs produits. - Leur lutte avec l'organisme
0024 - Page 20 - Chapitre premier. Prolégomènes. Principes généraux de l'antisepsie médicale. I. L'antisepsie s'adresse aux maladies infectieuses. - Malignité. - Contagion. - Épidémicité. - Maladies qui vaccinent. - Maladies qui ne vaccinent pas. - Maladies qui prédisposent à une nouvelle atteinte. - Notions générales sur les conditions d'existence des germes pathogènes. - Leurs produits. - Leur lutte avec l'organisme
-
 0031 - Page 27 - II. La stérilisation de l'organisme est-elle possible ? - Antagonisme entre certains états morbides et les maladies infectieuses. - Individus réfractaires au choléra, à la diphthérie, à la malaria. - Inversement, individus prédisposés par des maladies antérieures
0031 - Page 27 - II. La stérilisation de l'organisme est-elle possible ? - Antagonisme entre certains états morbides et les maladies infectieuses. - Individus réfractaires au choléra, à la diphthérie, à la malaria. - Inversement, individus prédisposés par des maladies antérieures
-
 0035 - Page 31 - III. Antisepsie préventive, asepsie. - Contagion directe et à distance. - Contagion par l'air, les eaux, les aliments, les produits d'excrétion, etc. - Nécessité de l'antisepsie préventive démontrée par des exemples
0035 - Page 31 - III. Antisepsie préventive, asepsie. - Contagion directe et à distance. - Contagion par l'air, les eaux, les aliments, les produits d'excrétion, etc. - Nécessité de l'antisepsie préventive démontrée par des exemples
-
 0041 - Page 37 - IV. Antisepsie des surfaces de l'organisme. - Les germes sont insérés sur elles. - Il faut les empêcher de franchir les épithéliums et de pénétrer dans le milieu intérieur. - Lutte contre les microbes et les ptomaïnes. - Emploi des agents antiseptiques et des désinfectants
0041 - Page 37 - IV. Antisepsie des surfaces de l'organisme. - Les germes sont insérés sur elles. - Il faut les empêcher de franchir les épithéliums et de pénétrer dans le milieu intérieur. - Lutte contre les microbes et les ptomaïnes. - Emploi des agents antiseptiques et des désinfectants
-
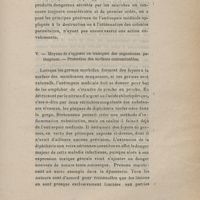 0045 - Page 41 - V. Moyens de s'opposer au transport des organismes pathogènes. - Protection des surfaces contaminables
0045 - Page 41 - V. Moyens de s'opposer au transport des organismes pathogènes. - Protection des surfaces contaminables
-
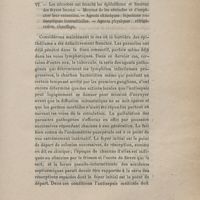 0047 - Page 43 - VI. Les microbes ont franchi les épithéliums et forment des foyers locaux. - Moyens de les atteindre et d'empêcher leur extension. - Agents chimiques ; injections antiseptiques interstitielles. - Agents physiques ; réfrigération, chauffage
0047 - Page 43 - VI. Les microbes ont franchi les épithéliums et forment des foyers locaux. - Moyens de les atteindre et d'empêcher leur extension. - Agents chimiques ; injections antiseptiques interstitielles. - Agents physiques ; réfrigération, chauffage
-
 0054 - Page 50 - VII. Les parasites pathogènes sont dans la lymphe et dans le sang. Antisepsie diffuse ou du milieu intérieur proprement dit. - Diffusion métastatique des bactéries pathogènes. - Parasites à habitat électif : parasites du sang extravasé, du sang circulant, de la masse du tissu connectif et de la lymphe. - Principes de l'antisepsie diffuse : tuer les microbes sans tuer la cellule humaine adjacente. - Équivalents antiseptiques et équivalent toxique des agents employés. - Antiseptiques spéciaux et antiseptiques généraux. - Les spécifiques des maladies infectieuses sont peut-être simplement des antiseptiques ; exemple du rhumatisme, maladie ambiguë. - Conclusion
0054 - Page 50 - VII. Les parasites pathogènes sont dans la lymphe et dans le sang. Antisepsie diffuse ou du milieu intérieur proprement dit. - Diffusion métastatique des bactéries pathogènes. - Parasites à habitat électif : parasites du sang extravasé, du sang circulant, de la masse du tissu connectif et de la lymphe. - Principes de l'antisepsie diffuse : tuer les microbes sans tuer la cellule humaine adjacente. - Équivalents antiseptiques et équivalent toxique des agents employés. - Antiseptiques spéciaux et antiseptiques généraux. - Les spécifiques des maladies infectieuses sont peut-être simplement des antiseptiques ; exemple du rhumatisme, maladie ambiguë. - Conclusion
-
 0069 - Page 65 - Chapitre II. Antisepsie médicale des surfaces d'origine ectodermique. I. Rôle protecteur des surfaces ectodermiques. - La peau et les muqueuses arrêtent les agents pathogènes. - Les cils vibratiles défendent l'entrée des voies respiratoires
0069 - Page 65 - Chapitre II. Antisepsie médicale des surfaces d'origine ectodermique. I. Rôle protecteur des surfaces ectodermiques. - La peau et les muqueuses arrêtent les agents pathogènes. - Les cils vibratiles défendent l'entrée des voies respiratoires
-
 0072 - Page 68 - II. Antisepsie du tégument externe. - Mode de pénétration des germes. - Rôle des plaies et des fissures cutanées. - Traitement antiseptique de la pustule maligne, de l'érysipèle, du chancre simple, des furoncles. - Maladies générales consécutives à des maladies de la peau ; néphrites infectieuses. - L'antisepsie faite sur la peau est, selon les cas, prophylactique ou curative
0072 - Page 68 - II. Antisepsie du tégument externe. - Mode de pénétration des germes. - Rôle des plaies et des fissures cutanées. - Traitement antiseptique de la pustule maligne, de l'érysipèle, du chancre simple, des furoncles. - Maladies générales consécutives à des maladies de la peau ; néphrites infectieuses. - L'antisepsie faite sur la peau est, selon les cas, prophylactique ou curative
-
 0078 - Page 74 - III. Antisepsie des muqueuses : bouche et pharynx. - Fréquence de la contagion. - Traitement des stomatites et des angines
0078 - Page 74 - III. Antisepsie des muqueuses : bouche et pharynx. - Fréquence de la contagion. - Traitement des stomatites et des angines
-
 0081 - Page 77 - IV. Antisepsie des muqueuses des voies aériennes : fosses nasales, larynx et bronches. - Leur contamination par l'air ou par propagation des angines. - Utilité de détruire les foyers locaux. - Emploi des solutions antiseptiques portées sur les parties malades. - Emploi des inhalations et des pulvérisations. - Traitement antiseptique de l'ozène, du croup, de la phthisie laryngée. - Traitement du laryngo-typhus par les pulvérisations de liqueur de Van-Swieten. - Traitement de la coqueluche, de la grippe, des bronchites. - Résultats obtenus
0081 - Page 77 - IV. Antisepsie des muqueuses des voies aériennes : fosses nasales, larynx et bronches. - Leur contamination par l'air ou par propagation des angines. - Utilité de détruire les foyers locaux. - Emploi des solutions antiseptiques portées sur les parties malades. - Emploi des inhalations et des pulvérisations. - Traitement antiseptique de l'ozène, du croup, de la phthisie laryngée. - Traitement du laryngo-typhus par les pulvérisations de liqueur de Van-Swieten. - Traitement de la coqueluche, de la grippe, des bronchites. - Résultats obtenus
-
 0092 - Page 88 - V. Antisepsie dans la phthisie pulmonaire. - Découvertes de Villemin et de Koch. - Résistance des bacilles tuberculeux aux agents antiseptiques. - Deux indications dominent le traitement de la phtisie : augmenter la vitalité des tissus, diminuer celle des bacilles. - Inhalations et pulvérisations médicamenteuses. - Étude des faits cliniques. - Mode d'action des eaux thermales
0092 - Page 88 - V. Antisepsie dans la phthisie pulmonaire. - Découvertes de Villemin et de Koch. - Résistance des bacilles tuberculeux aux agents antiseptiques. - Deux indications dominent le traitement de la phtisie : augmenter la vitalité des tissus, diminuer celle des bacilles. - Inhalations et pulvérisations médicamenteuses. - Étude des faits cliniques. - Mode d'action des eaux thermales
-
 0100 - Page 96 - VI. De la chirurgie du poumon. - Son innocuité avec l'antisepsie. - Méthodes employées. - Pneumotomie. - Pneumectomie. -Injections intrapulmonaires de substances antiseptiques. - Exposé des résultats. - Avenir de ces méthodes
0100 - Page 96 - VI. De la chirurgie du poumon. - Son innocuité avec l'antisepsie. - Méthodes employées. - Pneumotomie. - Pneumectomie. -Injections intrapulmonaires de substances antiseptiques. - Exposé des résultats. - Avenir de ces méthodes
-
 0105 - Page 101 - VII. Antisepsie de la plèvre. - Pleurotomie antiseptique. - Lavages répétés et lavage unique. - Résultats obtenus
0105 - Page 101 - VII. Antisepsie de la plèvre. - Pleurotomie antiseptique. - Lavages répétés et lavage unique. - Résultats obtenus
-
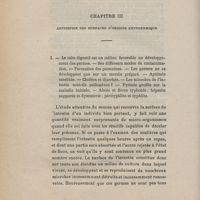 0108 - Page 104 - Chapitre III. Antisepsie des surfaces d'origine entodermique. I. Le tube digestif est un milieu favorable au développement des germes. - Ses différents modes de contamination. - Formation des ptomaïnes. - Les germes ne se développent que sur un terrain préparé. - Aptitude morbide. - Choléra et diarrhée. - Les microbes de l'intestin sont-ils pathogènes ? - Pyémie greffée sur la maladie initiale. - Abcès et fièvre typhoïde ; hépatite suppurée et dysenterie ; pérityphlite et typhlite
0108 - Page 104 - Chapitre III. Antisepsie des surfaces d'origine entodermique. I. Le tube digestif est un milieu favorable au développement des germes. - Ses différents modes de contamination. - Formation des ptomaïnes. - Les germes ne se développent que sur un terrain préparé. - Aptitude morbide. - Choléra et diarrhée. - Les microbes de l'intestin sont-ils pathogènes ? - Pyémie greffée sur la maladie initiale. - Abcès et fièvre typhoïde ; hépatite suppurée et dysenterie ; pérityphlite et typhlite
-
 0115 - Page 111 - II. La désinfection de l'intestin est l'adjuvant de l'antisepsie. - Découverte des ptomaïnes. - Elles sont produites par les cellules animales et par les microbes. - Leur élimination par le rein. - Leur destruction par le foie (Bouchard et Charrin). - Toxicité des urines
0115 - Page 111 - II. La désinfection de l'intestin est l'adjuvant de l'antisepsie. - Découverte des ptomaïnes. - Elles sont produites par les cellules animales et par les microbes. - Leur élimination par le rein. - Leur destruction par le foie (Bouchard et Charrin). - Toxicité des urines
-
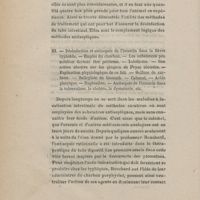 0118 - Page 114 - III. Désinfection et antisepsie de l'intestin dans la fièvre typhoïde. - Emploi du charbon. - Les substances peu solubles doivent être préférées. - Iodoforme. - Son action élective sur les plaques de Peyer ulcérées. - Explication physiologique de ce fait. - Sulfure de carbone. - Salicylate de bismuth. - Calomel. - Acide phénique. - Naphtaline. - Antisepsie de l'intestin dans la tuberculose, le choléra, la dysenterie, etc.
0118 - Page 114 - III. Désinfection et antisepsie de l'intestin dans la fièvre typhoïde. - Emploi du charbon. - Les substances peu solubles doivent être préférées. - Iodoforme. - Son action élective sur les plaques de Peyer ulcérées. - Explication physiologique de ce fait. - Sulfure de carbone. - Salicylate de bismuth. - Calomel. - Acide phénique. - Naphtaline. - Antisepsie de l'intestin dans la tuberculose, le choléra, la dysenterie, etc.
-
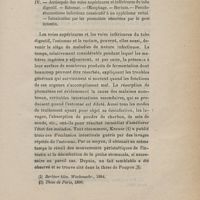 0129 - Page 125 - IV. Antisepsie des voies supérieures et inférieures du tube digestif. - Estomac. - Oesophage. - Rectum. - Pseudo-rhumatisme infectieux consécutif à un syphilome rectal. - Intoxication par les ptomaïnes résorbées par le gros intestin
0129 - Page 125 - IV. Antisepsie des voies supérieures et inférieures du tube digestif. - Estomac. - Oesophage. - Rectum. - Pseudo-rhumatisme infectieux consécutif à un syphilome rectal. - Intoxication par les ptomaïnes résorbées par le gros intestin
-
 0131 - Page 127 - V. Antisepsie de la cavité péritonéale. - Les péritonites infectieuses reconnaissent des causes multiples. - Antisepsie préventive du péritoine. - Traitement antiseptique
0131 - Page 127 - V. Antisepsie de la cavité péritonéale. - Les péritonites infectieuses reconnaissent des causes multiples. - Antisepsie préventive du péritoine. - Traitement antiseptique
-
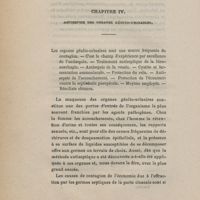 0134 - Page 130 - Chapitre IV. Antisepsie des organes génito-urinaires. Les organes génito-urinaires sont une source fréquente de contagion. - C'est le champ d'expérience par excellence de l'antisepsie. - Traitement antiseptique de la blennorrhagie. - Antisepsie de la vessie. - Cystite et fermentation ammoniacale. - Protection du rein. - Antisepsie de l'accouchement. - Protection de l'économie contre la septicémie puerpérale. - Moyens employés. - Résultats obtenus
0134 - Page 130 - Chapitre IV. Antisepsie des organes génito-urinaires. Les organes génito-urinaires sont une source fréquente de contagion. - C'est le champ d'expérience par excellence de l'antisepsie. - Traitement antiseptique de la blennorrhagie. - Antisepsie de la vessie. - Cystite et fermentation ammoniacale. - Protection du rein. - Antisepsie de l'accouchement. - Protection de l'économie contre la septicémie puerpérale. - Moyens employés. - Résultats obtenus
-
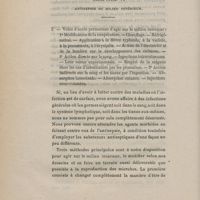 0148 - Page 144 - Chapitre V. Antisepsie du milieu intérieur. I. Voies d’accès permettant d'agir sur le milieu intérieur : 1° Modification de la température. - Chauffage. - Réfrigération. - Application à la fièvre typhoïde, à la variole, à la pneumonie, à l’érysipèle. - Action de l’électricité et de la lumière sur le développement des cultures. - 2° Action directe sur le sang. - Injections intraveineuses. - Leur valeur expérimentale. - Emploi de la saignée dans les cas d’intoxication par les ptomaïnes. - 3° Action indirecte sur le sang et les tissus par l’ingestion. - Absorption intestinale. - Absorption cutanée. - Injections sous-cutanées
0148 - Page 144 - Chapitre V. Antisepsie du milieu intérieur. I. Voies d’accès permettant d'agir sur le milieu intérieur : 1° Modification de la température. - Chauffage. - Réfrigération. - Application à la fièvre typhoïde, à la variole, à la pneumonie, à l’érysipèle. - Action de l’électricité et de la lumière sur le développement des cultures. - 2° Action directe sur le sang. - Injections intraveineuses. - Leur valeur expérimentale. - Emploi de la saignée dans les cas d’intoxication par les ptomaïnes. - 3° Action indirecte sur le sang et les tissus par l’ingestion. - Absorption intestinale. - Absorption cutanée. - Injections sous-cutanées
-
 0156 - Page 152 - II. Antiseptiques généraux. - Mercure. - Le calomel et la salivation dans les maladies infectieuses. - Signification de la salivation. - Importance de la méthode des doses fractionnées. - L’acide phénique est-il applicable ? - Antithermiques. La plupart agissent comme antiseptiques
0156 - Page 152 - II. Antiseptiques généraux. - Mercure. - Le calomel et la salivation dans les maladies infectieuses. - Signification de la salivation. - Importance de la méthode des doses fractionnées. - L’acide phénique est-il applicable ? - Antithermiques. La plupart agissent comme antiseptiques
-
 0159 - Page 155 - III. Antiseptiques spéciaux.- Arsenic. Benzoate de soude. Acide benzoïque. - Mercure et quinine. - Le mercure contre la syphilis. Etude de son action. - C’est un reconstituant des globules du sang. - Il n’est pas anticongestif. - Il est antiparasitaire. - Démonstration de ce fait
0159 - Page 155 - III. Antiseptiques spéciaux.- Arsenic. Benzoate de soude. Acide benzoïque. - Mercure et quinine. - Le mercure contre la syphilis. Etude de son action. - C’est un reconstituant des globules du sang. - Il n’est pas anticongestif. - Il est antiparasitaire. - Démonstration de ce fait
-
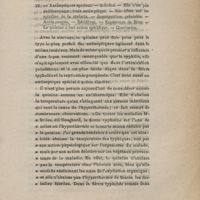 0163 - Page 159 - IV. Antiseptiques spéciaux. - Quinine. - Elle n’est pas antithermique, mais antiseptique. - Ses effets sur les spirilles de la malaria. - Imprégnation préalable. - Accès coupés. - Récidives. - Expérience de Binz. - La quinine a une action spécifique. - Conclusion
0163 - Page 159 - IV. Antiseptiques spéciaux. - Quinine. - Elle n’est pas antithermique, mais antiseptique. - Ses effets sur les spirilles de la malaria. - Imprégnation préalable. - Accès coupés. - Récidives. - Expérience de Binz. - La quinine a une action spécifique. - Conclusion
-
 0169 - Page 165 - Notes et pièces justificatives. I. De la valeur comparée des antiseptiques
0169 - Page 165 - Notes et pièces justificatives. I. De la valeur comparée des antiseptiques
-
 0171 - Page 167 - II. Des équivalents thérapeutiques
0171 - Page 167 - II. Des équivalents thérapeutiques
-
 0173 - Page 169 - III. De l'action antiseptique du talc iodé
0173 - Page 169 - III. De l'action antiseptique du talc iodé
-
 0174 - Page 170 - IV. Note sur le traitement de la diphthérie
0174 - Page 170 - IV. Note sur le traitement de la diphthérie
-
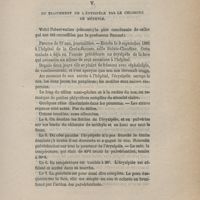 0175 - Page 171 - V. Du traitement de l'érysipèle par le chlorure de méthyle
0175 - Page 171 - V. Du traitement de l'érysipèle par le chlorure de méthyle
-
 0176 - Page 172 - VI. Notes sur le traitement de la tuberculose
0176 - Page 172 - VI. Notes sur le traitement de la tuberculose
-
 0177 - Page 173 - VII. Fièvre typhoïde. - Antisepsie intestinale
0177 - Page 173 - VII. Fièvre typhoïde. - Antisepsie intestinale
-
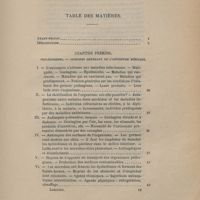 0181 - Page 177 - Table des matières
0181 - Page 177 - Table des matières
- Univers Numerabilis
- Médecine
- Sur l'auteur
- Lemoine, Georges Henri (1859 - 1940)
- Autre consultation
- Consulter en PDF
